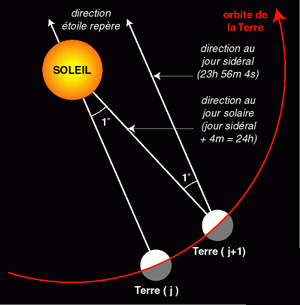1) Les faits expérimentaux
On constate que le Soleil se déplace dans le ciel. Mais il n'est pas le seul, tous les objets astronomiques se déplacent dans un
mouvement d'ensemble dans lequel ils sont solidaires, et de période environ 24h. Bien sûr, ce mouvement est interprété comme la conséquence du mouvement
de rotation de la Terre sur elle-même. Mais voyons plus en détail comment on peut étudier le mouvement du Soleil.
La photographie ci-contre à droite nous montre un petit tube dont la direction est repérée par deux angles par rapport à l'ensemble,
qui est supposé être placé sur un sol horizontal et orienté vers le Sud (à l'aide de la boussole
que l'on voit sur l'arrière de la photographie) : l'angle de direction horizontal, ou azimuth, et l'angle de hauteur
au dessus de l'horizon. On peut par la mesure de ces deux angles, complètement repérer la position du Soleil dans le ciel
pour différents moments de la journée, car quand le tube
a la même direction que le Soleil, la lumière du Soleil le traverse
(on peut également utiliser un
saladier transparent pour cette expérience). On se rend compte que peut importe la distance du Soleil pour ce genre d'observation,
et
on peut considérer que tous les
astres sont à la même distance sur une sphère fictive, la sphère céleste.
On
arrive alors à la représentation du mouvement du Soleil
sur le dessin du dessous extrait de livre de la collection Tournesol CM1 par Marc Antoine Hatier 1996. Ce dessin est une représentation en perspective
d'une maquette où l'on voit que la trajectoire du Soleil est un cercle sur la sphère céleste. Comment retrouver théoriquement ces résultats?
En ce qui concerne l'utilisation de la boussole,
l'angle actuel entre le Nord géographique et le Nord magnétique appelé déclinaison magnétique
est négligeable.
2) L'animation sphère céleste
Sur
l'animation obtenue avec ce lien, on peut choisir la date. Cela nous renvoie au mécanisme des saisons étudié ci-dessous.
À une date donnée, le Soleil a une certaine position dans le ciel,
donc sur la sphère céleste. Il est au milieu d'une certaine constellation (ensemble conventionnel d'étoiles
dans des directions voisines)
du zodiaque (constellations où le Soleil peut se trouver), comme on le voit également
sur la deuxième animation.
On observe la Terre qui tourne sur elle-même, entraînant le mécanisme des jours et des nuits.
Cependant le mouvement, pour être décrit mathématiquement, a besoin de deux objets qui bougent l'un par rapport à l'autre. Si l'Univers se
ramenait à un seul objet tout seul, cela n'aurait aucun sens de parler de son mouvement. De plus, il est complètement conventionnel de choisir
un objet ou l'autre comme immobile : en tant qu'observateur, on peut se considérer comme fixé sur un objet ou sur
l'autre au choix. Par conséquent on peut à loisir supposer que la Terre est immobile
et que c'est la sphère céleste qui tourne en sens inverse. On obtient cette animation en cliquant sur "Cliquer ici pour changer de référentiel".
Avec le curseur en haut à gauche, on peut alors changer l'orientation de l'ensemble, ce qui ne change rien au phénomène. Mais
ainsi, on peut amener le plan horizontal du lieu de latitude choisie à être effectivement vu comme horizontal. Il ne reste plus qu'à déplacer
à fond à droite le curseur en haut à droite de la page pour voir apparaître le plan horizontal du lieu qui masque, pour un observateur sur la Terre
tout ce qui est en dessous. On retrouve bien les résultats des observations du paragraphe 1. La trajectoire du Soleil dans le ciel résulte donc
bien complètement de la rotation de la Terre sur elle-même. On peut d'autre part, avec cette animation découvrir la trajectoire du Soleil
pour différentes latitudes. On découvre ainsi qu'à l'équateur le Soleil s'enfonce verticalement sous l'horizon ce qui entraîne des crépuscules
très courts, tandis qu'aux pôles, le Soleil garde une hauteur constante. La succession des jours et des nuits n'existe plus.
Avec le deuxième curseur en partant du haut à droite, on peut positionner à la main le Soleil où on veut, et vérifier ainsi
avec le dessin en bas à droite et l'heure solaire qui s'affiche en rouge en bas à gauche, que le Soleil culmine au Sud
(pour les régions de l'hémisphère Nord) à midi solaire. L'ombre d'un bâton est alors la plus courte et dirigée vers le Nord. On constate sur la vidéo
ci-contre à droite au dessus, le décalage horaire pour deux bâtons de longitudes différentes; tandis que sur la deuxième vidéo en dessous, on voit
la différence de hauteur du Soleil,
ici pour des régions de latitudes différentes, qui
entraîne une différence de
chauffage par le Soleil.
3) Rotation des étoiles autour de la polaire.
Tournez sur vous-même en maintenant le cou rigide et la tête fixe par rapport au corps. Vous verrez le paysage défiler devant vos yeux. Mais
si vous regardez à la verticale, le point du plafond au-dessus de votre tête vous semblera fixe. Tout le plafond tourne autour de ce point.
Si vous tournez sur vous-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le plafond tourne dans le même sens.
Sur l'animation jointe, cliquez sur "Voir le ciel", puis déplacer le curseur "Réglage fin"
en bas à droite, à fond vers la droite. On voit tout le ciel tourner autour de la polaire. On a vu effectivement avec
l'autre animation, que l'on pouvait considérer que c'était toute la sphère céleste
avec toutes les galaxies et les étoiles qu'elle contient qui tournait
autour de la Terre. Il résulte de cela que l'étoile polaire, étoile qui est située
dans la direction de l'axe des pôles au dessus du Pôle Nord, est vue fixe. On voit avec
cette animation
quand le sol est mis en place,
quand on change la latitude, que la hauteur de l'étoile polaire au dessus de l'horizon est égale à la latitude du lieu.
Sur la photo ci-contre à droite, on voit le résultat d'une pose photographique vers l'étoile polaire qui confirme le résultat
de la rotation des étoiles autour de la polaire. On observe que les étoiles sont
colorées.
Le temps que met une étoile pour revenir au même endroit dans le ciel après avoir fait un tour autour de l'étoile polaire est le jour sidéral
de 23 heures 56 minutes. Pendant ce temps, le Soleil a dérivé sur le fond des étoiles, dans le sens des aiguilles
d'une montre autour de la polaire, de 1° environ.
Ce mouvement apparent du Soleil
sur le fond des étoiles est dû au
mouvement de rotation de la Terre autour du Soleil en un an. Il faut donc un peu plus de temps, soit
24h en moyenne
pour que le Soleil revienne au Sud par exemple après avoir fait un tour; c'est le
jour Solaire.
Suite : les saisons